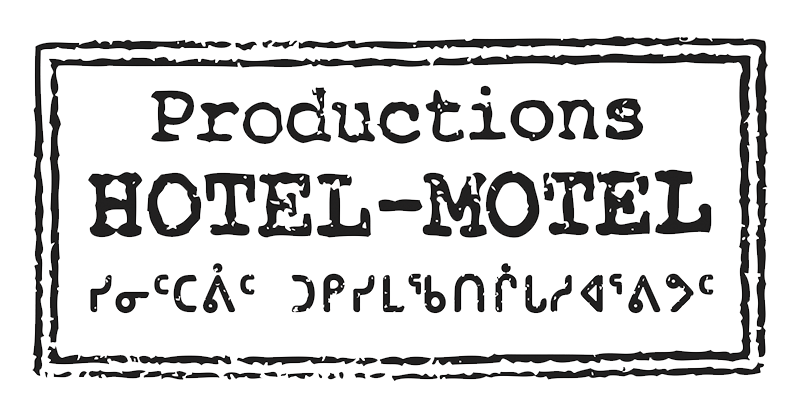01 Jan Les lanceurs de pierres (Palestine, Israël – 2005, 2006, 2009)
À la main de Fatma, les doigts ne sont pas tous de la même longueur.
« Presque comme une erreur, des fois, le chemin qu’on prend dans la vie nous change complètement. Sans vraiment qu’on s’y attende. En tout cas, pas comme ça, pas autant que ça. Ma route m’a mené jusqu’ici, en Palestine, en pleine occupation. C’est mon choix, c’est sûr. Mais qu’est-ce qui nous pousse sur les routes? Qu’est-ce qui nous dirige vers un endroit comme la Palestine au lieu d’aller sur les plages du Mexique? Qu’est-ce qui fait qu’on prend l’avion, qu’on plonge dans la tristesse, l’épuisement, qu’on fait face à la nature même du désespoir et qu’on change de vie? Il serait facile d’avoir des réponses toutes faites, de parler du réel sentiment de responsabilité, du désir insatiable de justice et de vérité, de compassion et d’humanité… Ce serait vrai. C’est vrai. Mais n’y a-t-il pas quelque chose d’autre qui nous y pousse? Une rencontre toujours plus profonde avec soi? Toujours plus extrême? Une rencontre avec toutes les facettes de l’homme en nous, du monstre à l’ange, avec tous nos destins possibles. C’est vrai, ça aussi. Et si c’est soi que l’on rencontre sur ces routes, c’est que ceux qu’on y croise, ceux qui y vivent, deviennent peu à peu nous. C’est qu’au fond, ils sont nous, ils sont moi.

J’ai donc pris l’avion. Deux même. Dans le sens de rotation de la Terre. Sachant très bien que revenir allait être à contresens. J’étais déjà allé à Beyrouth, dans les camps du Liban, dans ses discothèques et sur ses autoroutes. J’avais aussi traversé la frontière vers Damas et monté le minaret de la mosquée des Omeyyades d’Alep. J’ai encore plein d’amis là-bas. J’avais déjà voyagé. Mais rien ne peut préparer à ce qu’implique l’occupation. On ne peut pas la lire, on ne peut pas la regarder au cinéma, on ne peut pas l’imaginer. Et la colère, le désespoir sont montés en moi, malgré moi; la violence quotidienne a fait bouillir mon sang et j’ai vu rouge. Mes mots sont devenus durs, mon regard explosif. À l’ombre des monstres et de l’oppression, à l’ombre du mur, le monde est laid. Je ne veux pas peser mes mots. La fin du monde existe tous les jours. Qui est responsable? Les manipulateurs de désespoirs, la drill des mégaphones et les corrompus ont leur part, c’est sûr. Et le droit à la défense est indéniable. Mais mes mots sont lourds, parce qu’il y a deux poids, deux mesures; mais il n’y a qu’un occupant et un occupé. Et parce que le silence règne. Il faut dire la violence de l’occupation. Il faut dire le crime ignoble de ses colonies, le désespoir planifié.
Il faut dire. »
Extrait du livre Les lanceurs de pierres

Je suis allé trois fois en Palestine et en Israël. J’y étais en 2009 lors de l’opération plomb durci qu’Israël a lancée contre Gaza. J’y ai compris que l’horreur ne rentre pas dans un écran de télé. L’occupation est une machine à broyer indescriptible. Et elle dévore aux yeux de tous. Ce festin macabre, nous l’acceptons. Lors de ces voyages, je voulais parler des hommes mais ce sont les monstres qui font l’histoire. Les hommes ne sont que les virgules, les accents. J’ai pourtant voulu désespérément m’accrocher à cette humanité, aux gens, à l’odeur de leurs plats et à la saveur de leurs rêves déchus. C’est cette humanité que j’ai voulu présenter à travers ces carnets et ces photos. Les carnets sur la Palestine et Israël ont été publiés chez Lansman sous le titre Les lanceurs de pierres. À la même époque, je suis aussi allé au Liban et en Syrie, et dans les camps de réfugiés palestiniens de ces pays. Encore une fois, j’y ai aussi écrit des carnets, publiés encore une fois chez Lansman sous le titre, La rupture du jeûne. Ces voyages charnières pour moi, m’ont permis aussi d’écrire une pièce de théâtre, L’affiche.

Derrière les photos, les carnets et le théâtre, il y a les gens. Derrière les guerres, les horreurs, ils sont là. Derrière les statistiques, les traités et les nouvelles de 6 heures, ils existent, aiment, rêvent et rient même. Ils la vivent, l’occupation, ils font face avec leur sang, leurs pleurs et leurs âmes à sa machine de l’oppression, à son ampleur insensée, à sa violence innommable. Derrière les checkpoints, derrière l’omniprésence vampirique des colonies, derrière le mur, derrière les barbus et les gradés, il y a eux. Ces photos et ces carnets ne sont que des fenêtres, des instants qui continuent de vivre, de battre, de se battre. En ce moment, de nouvelles affiches sont imprimées; en ce moment, des martyrs tombent, des enfances sont dévorées. Ce soir, quand on se couchera, le mur lui, sera encore debout.
Ces fenêtres, ces mots, ces images, parlent de nous. De l’humain en nous. Celui qui se tient debout, dos au mur, et qui regarde droit dans les yeux de la Terre et de ses ombres, celui qui cherche à voir. Se fermer les yeux, c’est accepter. Il faut voir. Il faut dire et il faut chercher à comment espérer.
Philippe Ducros
MOHAMED LE COIFFEUR (LE VERT EST LA COULEUR SACRÉE DE L’ISLAM)
Il y a des gens de l’autre côté de ma télé qui sont en train de suffoquer. Et comme les caméras de surveillance surveillent, jamais ils ne mourront tout à fait. Ils ne deviendront que des bibelots que l’on dépose sur la télé. Et la poussière s’accumulera sur l’horreur.

Ils nous regardent. Mais comme les caméras de surveillance n’enregistrent pas le son, on n’écoute pas. Ils sont là. Et moi, j’ai appris leur prénom. J’ai connu leurs chants dans les cafés, le soir dans le mirage de fumée des narguilés. Leurs blagues et leurs histoires. Elles sont rarement explosives, leurs histoires… Elles ne disent pas les enfants morts. Ça, ici tout le monde sait. Et tout le monde voit tous les jours l’affiche de la petite Nadia qui devient bleue au soleil. Elle a regardé du toit de sa maison quand les soldats passaient. Ils l’ont tiré. Elle avait treize ans. Ils ont peur, les soldats. Alors, c’est lourd. Alors, on n’en parle pas. Parce que personne n’écoute sauf ceux qui savent.

Mohamed, pas le Prophète, le coiffeur. Celui qui conte et qui chante au café de Ramallah. Mohamed change de sujet. Il conte une blague. Entonne un chant. Le soir, au café de Ramallah, il y a foule pour entendre Mohamed le coiffeur chanter. Et parler des soldats. Et de l’enfant qui, sans le savoir, a pissé d’un balcon sur le casque dur d’un soldat Ray Ban. Sans le savoir. Et tout le monde rit. On fume un peu, on boit un café et Mohamed chante une autre mélodie.
Lorsqu’on dit les vraies choses, chaque mot devient un attentat. Les tourelles, les checkpoints, les barbelés ne changeront rien. Les traités s’accumulent sur l’étagère des trahisons. Les gens du café n’y croient plus. Ni à l’Autorité palestinienne, d’ailleurs. Ils croient juste en Mohamed le coiffeur. Celui qui a une photo dans son portefeuille. La photo d’une femme en bikini, une femme qui fait le bien avec ses courbes, une missionnaire du croissant rouge avec le croissant de ses seins. C’est sa femme, qu’il dit. Mais on sait tous… On sait tout. Et on ne dit rien. Mohamed est un prophète de salon de coiffure et la femme du portefeuille, une héroïne. Elle est blonde. Et Mohamed conte une autre histoire. Et tout le monde rit. On fume, on prend une autre gorgée de thé, on avale une pistache.
On a mis un fusil à la tempe de ma télé pour qu’elle parle d’autres choses. Parce que si les mots pouvaient faire trembler les hommes, faire chanter des chansons d’amour aux minarets ou décrocher les étoiles des drapeaux, la mer Rouge pourrait enfin se refermer et la mer Morte pourrait se taire. On écouterait les hommes. On écouterait Mohamed le coiffeur.

En riant, il nous raconte toujours la même histoire, il chante toujours la même chanson : le jour à jour de l’occupation. Et comme je suis là, ils s’y mettent tous, ils me parlent tous en même temps. C’est l’histoire de leur pays, celle qui pousse entre les arbres généalogiques et les oliviers décapités. On ne l’entend pas à la télé, cette histoire-là. Elle a peur, la télé. Comme les soldats.
Ils occupent tout, qu’ils me disent.

Ils occupent chacun de nos pas, de nos déplacements, avec des checkpoints et des permis expirés. On ne peut plus sortir de Naplouse. Ni de Qalqiliya. Plus de 500 checkpoints en Cisjordanie. Depuis des décennies. Les checkpoints sont fermés. Des milliers d’hommes travaillaient en Israël, bouclés. Avec eux l’argent pour les familles, les souliers des enfants et les livres, l’argent pour les aubergines. Les professeurs. Le père d’un enfant cancéreux refusé de passage, il n’a pas 40 ans. Cataractes refoulées, cardio-déficients refoulés, paralysés refoulés, médecins aussi. Légumes, fruits, pièces de moteurs, bouclés. Employés humanitaires, observateurs, journalistes, artistes, refusés. Restez dehors, on n’entre pas, restez chez vous, fermentez, le checkpoint est fermé. Désolé. Accouchez ici, accouchez où vous voulez, mais circulez. Le checkpoint est fermé. Et au checkpoint Erez, seul lien entre Gaza et le reste du monde, la voix du soldat crie dans le haut-parleur Don’t move, I can kill you, I can kill you…

Ils occupent nos familles, notre sang. Toutes les mères ont un fils en prison ou un mari qui en sort. Toutes les sœurs savent attendre devant les baraques pour donner des oranges aux prisonniers. 8 000 Palestiniens détenus actuellement dans les prisons israéliennes, dont 300 mineurs.
Ils occupent nos maisons. Des dizaines de milliers d’entre elles, détruites. Des centaines rasées chaque année. Démolitions punitives. Permis expirés. La mienne aussi est détruite. Un de mes fils est recherché et je refuse de vendre mes enfants. Quand ils l’ont fait exploser, ils ont aussi rasé celle de mes deux voisins. Mes voisins ne m’en veulent pas. Eux aussi refuseraient de vendre leurs enfants.

Ils occupent l’eau. Le Jourdain est presque entièrement détourné avant d’entrer en Cisjordanie. La mer Morte en baisse d’un mètre par année. Dépêchez-vous de la visiter! Et les plus grands puits artésiens du nord de la Cisjordanie sont dorénavant de l’autre côté du mur. Ils occupent nos larmes avec leurs lacrymogènes, et notre démographie avec leurs erreurs et leurs assassinats sélectifs. Target killing is a mitzvah, disaient les prospectus lors de la fête de Pourim…

Ils occupent notre terre, la scarifient de routes qui nous sont interdites, la brûlent pour l’installation de leurs frontières, de leurs barrières, la lacèrent à la scie mécanique. Ils coupent nos oliviers. « Derrière chaque arbre, il y a un terroriste », qu’ils disent. Des centaines de milliers d’oliviers décapités pour la construction du mur, pour tout, pour rien, on ne sait pas, on n’ose pas demander.

Ils occupent tout Gaza. Je ne suis pas entré à Gaza. Personne n’entre ni ne sort de Gaza. 40 kilomètres par 10. Plus de 2 000 000 de Palestiniens emprisonnés. Il y a là-bas le camp de réfugiés de Jabālīyah : 116 000 habitants sur 1,4 km carré. C’est la plus haute densité de population au monde. Au début 2009, ils ont tout bombardé. Même trois écoles de l’ONU, 42 morts dans l’une d’elles. Même le QG de l’ONU et ses entrepôts. 1 300 morts en tout dont plus de 400 enfants, 5 300 blessés, 22 jours de bombardements. Pourquoi exactement?

Ils occupent nos montagnes avec leurs colonies. Ils contrôlent l’espace par leurs colonies, l’espoir par leurs colonies, le droit au retour par leurs colonies, les frontières par leurs colonies, le paysage par leurs colonies, les déplacements par les routes qui mènent à leurs colonies, l’eau qui est bue par leurs colonies, la rage par la pensée qu’on n’aura jamais de terre ou de pays parce qu’il y a trop de colonies. Ces mêmes colonies accouchent de radicaux que même l’armée de l’occupant ne sait pas contrôler. 250 colonies en Cisjordanie qui occupent plus de 40 % du territoire, et qui abritent plus de 700 000 adorateurs de murs à qui Dieu a donné la terre. Leurs plaques d’immatriculation sont jaunes, les nôtres sont vertes de rage. Après tout, le vert est la couleur sacrée de l’islam.

Ils contrôlent nos puits, nos routes, nos papiers, nos oliviers. Les troncs sont nus. Les olives, sèches. Nos villes n’ont plus d’arbres et nos champs sont de l’autre côté du mur. De toute façon, il n’y a plus d’eau pour les irriguer. 8 mètres de haut, le mur. 710 kilomètres de long. Qalqiliya est littéralement encerclée par le mur… À gauche, le mur. À droite, le mur. Par la fenêtre, le mur. Au bout de la rue, entre nous et les labours, entre le futur et les enfants, le mur. Au nord, le mur. Au sud, le mur. À l’ouest, le mur. À l’est, un seul passage par où sortir, des barbelés et une tourelle. Dans la tourelle, derrière des lunettes fumées, un soldat, jeune, nerveux. Derrière lui, le monde.
L’après-midi, on ne peut plus se rassembler à l’ombre sous les arbres du village après une bonne journée de travail. Il n’y a plus de village. Il n’y a plus d’arbres, plus d’ombre. Et plus de travail. Nos hommes tournent en rond et essayent de ne pas penser à la colère.
Ils occupent nos pensées. Si on ne les contrôle pas, elles tuent. Eux ou nous. Peu importe, elles tuent.
Ils occupent nos corps par leurs tortures. Quarante jours d’interrogatoire en moyenne avant de passer devant un juge. Ils occupent nos corps même hors des prisons… La faim. Le froid des toits de tôle, l’épuisement de la révolte, la douleur de l’attente, le soleil des checkpoints.

Ils contrôlent nos mots, nos écoles. Le mot checkpoint en palestinien est un mot hébreu. Machsom. Les écoles sont fermées. Les jeunes qui ne peuvent plus étudier s’insurgent, mais la répression est efficace. Les rues sont bloquées par des jeeps, les villes par des machsoms, les classes par des soldats. Les étudiants ne savent plus quoi faire de leur temps. Ils jouent alors avec des explosifs et apprennent à canaliser leur colère trop verte pour être contenue dans le silence des pierres. Le vert est la couleur de l’islam.

Ils occupent notre temps. 6 générations dans les camps. 70 ans d’occupation. 6 heures d’attente au checkpoint. Deux semaines que le couvre-feu est total, des décennies que la bande de Gaza est hermétiquement bouclée. 40 jours d’interrogatoire, 40 mois de prison, 5 ans sans voir ma famille à Gaza. Deux heures pour venir le matin, deux heures pour rentrer le soir si les checkpoints sont ouverts. Celui de Surda. Celui de Qalandiya. Et les autres. Et l’on perd la notion du temps. Trois ans sans travail. Trois sentences à vie, où la torture, le noir des cellules d’isolement et l’absence de repères te font perdre la valeur d’une seconde, d’une année. Le cœur ne sait même plus battre.

Ils occupent nos fruits et nos légumes. Cette semaine, le chargement de tomates est passé; la semaine dernière, non. Il a été bloqué au checkpoint de Betiba. Ton père ne peut pas nous visiter, il est bloqué au checkpoint Erez. Je ne peux pas réparer ta voiture, la pièce est coincée au checkpoint d’Ohwara. De toute façon, où irais-tu?

Ils contrôlent notre mort. La petite Nadia, treize ans, abattue sur son toit. Interdit de regarder les soldats des toits. Un enfant frappé à la tête toutes les deux semaines, balle de caoutchouc ou autre. Les murs sont couverts d’affiches de morts, de martyrs. Les affiches se renouvèlent. Des fois, la même revient, mais il y a une photo de plus. Le frère aussi est mort. Des fois, ils sont trois sur l’affiche à devenir bleu au soleil.

Ils occupent tout. La vue par leurs murs, l’ouïe par leurs bombes, l’odorat par la mort, le goût par l’absence d’olives, le toucher par le dernier baiser du condamné. Et nos rêves sont occupés à décharger notre inconscient de toute la violence qu’on nous fait subir consciemment. Ne reste rien pour nous. Même la vue de ma fenêtre est dorénavant occupée. Ils ont construit un mur de 8 mètres de haut. Avant, je voyais les champs. Maintenant, je ne vois que du ciment. Alors, mes rêves aussi sont en ciment.
Nous ne sommes pas aveugles. On voit en haut de la montagne. On voit de l’autre côté du mur. Chez nous, c’est le tiers-monde, mais en haut de la montagne, c’est l’Occident. La colonie. Et le gazon de l’autre côté est réellement plus vert. Pourtant, le vert est la couleur de l’islam. C’est le seul bienfait du mur, cacher maladroitement l’abondance de celui qui vampirise… Le son de sa piscine.

L’homme épuisé de voir son champ dérobé, sa fiancée dénudée par le ciment de l’autre, par le vol, l’homme ne pleure plus. Il rage. Il rage vert. Il voit la blancheur des murs de ses ennemis. Mais peu importe que l’ONU déclare ces colonies illégales, et le mur aussi. Peu importe que le FMI déplore l’impact économique des bouclages sur la santé, que les 4 Conventions de Genève soient ignorées, que plus de 80 résolutions de l’ONU ne soient pas respectées. Tout le monde s’en fout.
Que reste-t-il dans le sein des mères? Le lait goûte quoi? Entre la mer Rouge et la mer Morte, ils apprennent à vivre sans levain, sans terrain, sans demain. La vie n’est plus que fumée dans une pipe, qu’une bulle du narguilé de Dieu. Le pain sans levain leur sert de livre d’histoire. Il est écrit au café amer, celui qu’on boit les jours de deuil, en écoutant le Coran.

Et peu à peu, à cause des couvre-feux et des patrouilles, des checkpoints et des bombardements, les rues se vident. Et les mosquées se remplissent. Mohamed le coiffeur devient Mohamed le Prophète. Il arrête de chanter du folklore. Il chante les louanges de Dieu et du M16, il déchire la photo de son portefeuille et fait porter un voile à la dame en bikini. Il n’a que Dieu comme refuge. Et les autres l’écoutent. Ses enfants auront le bandeau vert du jihad sur le front. Leurs yeux seront tous devenus verts. Parce que le vert est la couleur sacrée de l’islam.

2009. Hébron, centre industriel du sud de la Cisjordanie. Au centre-ville, une colonie. 600 colons vivent protégés par 2 000 soldats israéliens entourés par 175 000 Palestiniens. Plus de circulation, plus d’économie, plus de vie possible. Downtown, secteur H-2 où vivent les 600 colons, et 30 000 Palestiniens sous couvre-feu. Des fois 24 heures sur 24. Des fois pendant une semaine, des fois deux. Deux semaines sans sortir. Sans pain, sans rien. Que le silence. On mange des lentilles, le plat des pauvres, pendant que les soldats regardent les filles palestiniennes se déshabiller dans la lentille de leur M16.
À la sortie du secteur H-2, j’ai croisé un Palestinien, commerçant dans une des deux boutiques encore ouvertes pour les touristes. Je lui ai demandé : « How’s life? ». Comment va la vie? Il m’a répondu : « On ne peut pas demander à un homme sans emploi comment va le travail ou à un célibataire comment vont ses amours… C’est pareil pour nous avec la vie. »
Si vous voulez que les adolescents arrêtent de s’habiller avec des ceintures d’explosifs, donnez-leur quelque chose à perdre. Si vous voulez qu’ils arrêtent de tuer au nom de la vie, donnez-leur le sentiment d’en avoir une. La violence est devenue la normalité.
À Qalqiliya, il est écrit sur le mur qui encercle la ville : To exist is to resist.
Il faut mettre fin à l’occupation.

Ce texte a été écrit à la suite de trois voyages en Palestine occupée et en Israël,
le dernier datant de 2009, lors de l’opération Plomb durci.
13 morts, dont 3 civils du côté israélien,
1 300 morts, une majorité de civils, dont plus de 400 enfants du côté palestinien.
Les mots qui suivent restent principalement ancrés autour des années 2009.
Ce texte ne veut pas justifier le sang qui coule. Rien ne peut le justifier.
Chacune, chacun a droit à la sécurité, à la dignité.
Les Israéliens comme les Palestiniens.
Mais pour que le sang arrête de couler, il faut aussi tenter de comprendre.
J’essaie donc ici de nommer ce que j’ai vu.